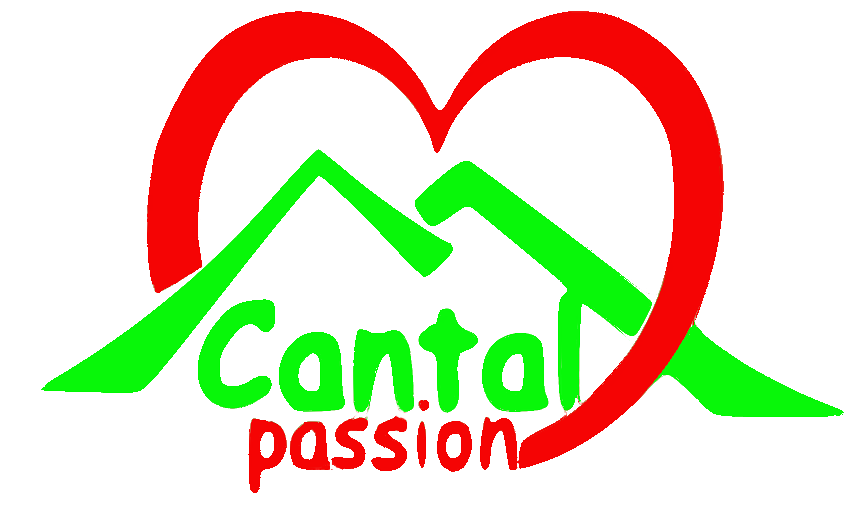Fait prisonnier le 29 mai 1940 à Loos près de Lille, Raymond Navarre, matricule 38.506 du Stalag III a, réussit son évasion qui s'étala sur une quinzaie de jours.
Appartenant à la classe 1931/2°, matricule 782 du recrutement d’Aurillac (Cantal), mobilisé le 27 août 1939 au C.M.A 313 à Clermont-Ferrand en qualité de Brigadier Pointeur à la 16ème Batterie du 21ème R.A.D.A, j’ai participé aux campagnes de Sare et de Belgique.
Capturé le 29 mai 1940 à Loos, près de Lille, dirigé sur le Stalag III a stationné à Lukenwalde, j’y fus immatriculé sous le numéro 38.506 et immédiatement expédié sur un chantier de réfection des voies près de Kustrin. Fin novembre 1940, le mauvais temps ayant interrompu les travaux, je fus affecté à l’Akdo F 319 (Stalag III a) stationné dans la scierie Barnewitz .Je fus incorporé dans une équipe composée exclusivement de PG français qui, à longueur de journée, chargeaient des wagons de pièces de bois sur l’embranchement particulier de l’établissement.
 Groupe P.G. : Raymond NAVARRE au dernier rang au milieu
Groupe P.G. : Raymond NAVARRE au dernier rang au milieu
Ce n’est qu’en janvier 1942, que j’appris que ces wagons étaient pour la plupart, destinés à l’organisation TOD, qui, à l’époque, avait des bases dans tous les pays occupés.
Cette information faisait immédiatement germer en mon esprit l’idée de l’évasion et j’en fis part à trois de mes camarades : Brisson Jules, Vignard Joseph et Velutini H qui furent d’accord pour tenter l’aventure.
Dès lors, tout en économisant toutes les denrées non périssables, nous nous mîmes en quête d’un équipement semi civil et surtout à la recherche d’un moyen permettant d’identifier avec certitude les destinations données aux wagons quittant le chantier.
Ce moyen devait nous être fourni six mois plus tard par Brisson qui était au mieux avec un nommé Reinke Arthur, contremaître allemand préposé aux expéditions, bien connu dans le Komando pour ses sentiments profrançais.
Le 30 juin 1942, Brisson était en effet en possession du détail d’une commande destinée à l’organisation TOD en France. Les équipements civils que nous nous étions procurés par des moyens différents allant du don pur et simple à la rapine, nous paraissent suffisants, disposant alors de 700 biscuits de guerre, de quelques dizaines de boites de conserve, de plusieurs kilos de sucre ou chocolat et de quatre bouteilles d’alcool de menthe, notre décision fut immédiatement prise : nous partirons !
La journée terminée, tous nos camarades de l’équipe de chargement furent mis au courant, copie du détail de la commande leur fut donnée, et la marche à suivre débattue en commun puis définitivement fixée comme suit:
1. Les quatre : Brisson, Vignard, Valutini et moi-même, qui avaient eu les premiers l’idée de l’évasion et se considéraient prêts partiraient seuls.
2. Pour désorienter les recherches et aussi pour tenir secrètes la «filière» utilisée, ils disparaîtraient dès le lendemain à l’heure du dîner des sentinelles, se cacheraient avec quelques provisions dans le grenier du bâtiment Bascule où ils attendraient que le chargement de la commande repérée fût ordonné et entrepris.
3. Lorsque le chargement serait en cours, les camarades qui en seraient chargés, ménageraient un couloir sur toute la longueur du wagon et dans l’extrémité sur la moitié de la largeur, puis avant de le recouvrir, scieraient deux traverses du plancher pour créer une trappe par laquelle nous pourrions entrer et sortir.
4. Ils procèderaient eux-mêmes à la mise en place dans le wagon du gros de nos provisions tenu caché et y adjoindraient deux des bidons de quinze litres, servant au transport du «rata», qu’ils rempliraient d’eau.
5. Ils nous indiqueraient par un chant collectif de la «Madelon» que tout était paré et que nous pourrions, au moment le plus propice, prendre place dans le chargement.
Tout se déroula comme prévu. Le 1er juillet au soir nous étions dans notre cachette et portés absents.
Au quatrième jour d’une attente rendue pénible par l’immobilité et le silence, la «Madelon» retentit. C’était le 5 juillet.
A l’heure du déjeuner, nous pouvions nous glisser dans le wagon aménagé à notre intention près de la bascule. Dans l’après-midi, nos camarades achevaient, sur nos têtes, le chargement. A 18 heures, passant près du wagon avant de rejoindre le cantonnement, ils nous prodiguaient leurs derniers encouragements. A la tombée de la nuit une machine vint, s’accrocha… Le grand voyage commençait.
Ce voyage, combien de fois en avions nous discuté, pesant tous les risques, nous fixant les précautions à observer, envisageant d’éventuels incidents, décidant de notre comportement dans chaque cas! Combien de fois l’ais-je, pour mon compte, répété dans mon sommeil!!
Maintenant nous roulions, et bien qu’à peu près surs des enseignements recueillis, par Brisson nous brûlions de connaître la direction prise par le convoi qui nous amenait.
Dans le bruit du train en marche nous pouvions causer, mais la nuit ne nous permettait pas d’identifier les stations. Il nous fallait patienter, et mieux valait essayer de se reposer. Pendant que deux d’entre nous essaieraient de dormir, les deux autres veilleraient pour faire taire le moindre bruit en cas d’arrêt.
Précaution prématurée car personne ne dormit cette nuit-là. Avec le jour qui finit par venir, nous pûmes, l’œil collé à tour de rôle à un trou d’un centimètre percé dans la paroi de notre wagon, voir défiler des maisons, des gares. Mais nous passions trop vite! Enfin un coup de frein, un bruit de saut sur les aiguilles, le train s’arrêtait à la hauteur d’un poste d’aiguillage sur la face duquel, l’un après l’autre, nous pûmes lire: Berlin, suivi d’un numéro. Nous allions vers l’ouest! Nous aurions chanté notre joie sans cette maudite consigne du silence.
Tout doucement le convoi se remit en marche pour aller s’immobiliser sur une voie de triage.
La première des longues et pénibles journées d’attente de silence absolu même aux heures où nous étions manœuvrés, commençait pour nous. Nous ne fûmes pas longs à comprendre que nous ne roulerions pas de nuit. Il nous tardait déjà de repartir pour retrouver le bruit qui nous permettait de causer, de bouger un peu, de manger en liberté et aussi de satisfaire nos besoins par la trappe du plancher.
Malheureusement, pas plus que le jour, nous ne devions rouler cette nuit-là. Nous en profitâmes, après avoir puisé silencieusement dans nos provisions et bu quelques gorgées d’eau (nous disposions pour la mesurer d’une boite de 1/8ème de litre), pour nous reposer un peu. Le roulement établi fut, cette nuit-là comme les suivantes, respecté, et lorsque le jour se leva, nous avions pris chacun quatre heures de sommeil.
Ce matin devait d’ailleurs nous apporter la première peur du voyage. Après avoir été déplacé plusieurs fois, noter wagon fut bientôt environné de cheminots allemands. De ce que nous pûmes saisir de leur conversation, le chargement ne paraissait pas leur convenir. Nous réalisâmes de suite que le couloir que nous occupions avait obligé nos camarades à charger plus haut que de coutume et nous nous mîmes à redouter un transbordement. Nos craintes devaient durer jusqu’au moment où, la nuit venue, nous nous remîmes à rouler, d’abord lentement, bientôt à la cadence de route. Nous quittions Berlin et poussions un «ouf» de soulagement!
Voyageant presque toujours de nuit, par petites étapes, notre randonnée allait se poursuivre sans trop d’encombre pendant quelques jours. Le 8, avant le jour, nous étions à Magdebourg, le 9 à Hanovre, le 10 à Kassel, le 11 à Francfort, le 12 à Maintz et nous espérions fermement être pour le 14 juillet en France.
Cette fois-ci nos espoirs devaient être déçus. Nous nous remîmes bien à rouler dans la nuit du 12 au 13, mais le matin nous nous trouvions à Koblentz et le 14 à Cologne. Ne connaissant pas les raisons qui avaient provoqué ce changement d’itinéraire, nous ne tardâmes pas à redouter le pire : le déchargement de notre wagon dans un chantier allemand ou Hollandais.
Si la suite de notre randonnée devait nous rassurer sur ce point, nous roulions à nouveau dès l’après-midi du 16 d’abord vers l’ouest, puis légèrement vers le sud-ouest, elle nous réservait d’autres sources de soucis dont deux allaient nous assaillir presque simultanément.
Ayant, comme je l’indiquais plus haut, longtemps conservé l’espoir d’être parvenus en France pour le 14 juillet, nous avions réglé notre consommation de boisson en conséquence. Aussi, ne disposions-nous, le 15 au matin, que de la réserve de sécurité, cinq litres, que malgré la chaleur torride de ce mois de juillet, nous nous étions astreints à respecter. Trois litres d’eau pour quatre! De quoi tenir un peu plus qu’une journée! Serait-ce suffisant pour tenir jusqu’au bout?
D’autre part, une bien désagréable surprise nous attendait à notre premier arrêt à Aachen. Le convoi, où à Cologne, on nous avait incorporé, devait être destiné à l’armée allemande, car nous constatâmes qu’il était convoyé et qu’une sentinelle en armes le longeait d’un bout à l’autre au cours du stationnement.
Presque plus d’eau, toujours plus de silence, telle était donc notre situation, lorsque nous quittâmes définitivement l’Allemagne.
Nous ne devions heureusement pas tarder à remarquer qu’à notre insu, nous venions d’entrer dans la phase la plus rapide de notre odyssée. Finies les petites étapes et les interminables séjours dans les triages! Sans qu’une seule fois notre convoi fut modifié, avec les seuls arrêts exigés par la circulation et les relais de locomotives, nous allions traverser la Belgique d’un seul trait.
Partis de Cologne vers 15 heures le 16 juillet, notre convoi ne s’arrêtait qu’un quart d’heure vers 16 heures à Aacken, pour être à Liège vers 18 heures, à Namur vers 19 heures30 d’où nous repartirions vers 20 heures 30.
Tout en roulant dans le bruit qui couvrait nos paroles, nous tenions conseil: A cette allure nous serions en France dans la nuit. Ne conservant que le strict nécessaire dans nos musettes, nous descendrions au premier arrêt, par la trappe qui donnait entre les essieux de notre wagon. Nous resterions tapis derrière les roues en attendant le passage de la sentinelle et sortirions ensuite du côté opposé.
Vers 23 heures, un long coup de frein ralentissait la marche du convoi et annonçait son prochain arrêt. Nous étions prêts, tout ce qui ne nous était plus utile avait été éjecté pendant la marche. Les roues ne s’étaient encore pas immobilisées que Frisson était déjà assis au bord de la trappe, les pieds dans le vide. A la dernière réaction il se laissait glisser sur la voie où nous nous retrouvions bientôt tous les quatre. Allongés près du rail, immobiles, nous n’attendions pas longtemps. Un bruit de pas bottés, une ombre qui nous effleure, ça y est, l’allemand est passé! Sans bruit nous sortons à contre-voie pour nous réfugier à l’abri d’une rame en stationnement en attendant le départ du convoi qui nous a amené.
Lorsque enfin il se fut éloigné, sans perdre de temps, comme il avait été convenu, j’abandonnais sur place mes trois camarades, repérais les lieux où ils allaient m’attendre (voie 16 sous un pont supérieur), et porteur de la carte de service S.N.C.F qui était toujours restée en ma possession, je partais en reconnaissance.
Moins d’un quart d’heure après, je tombais sur une équipe de cheminots français, installés dans un abri souterrain.
Je n’oublierai jamais l’accueil qui me fut réservé! Outre ma barbe de 15 jours, ma tenue hétéroclite et poussiéreuse exigeaient des explications, mais dès que je les eues données, j’étais, nous étions adoptés. Sans que j’eusse à m’en occuper, mes trois camarades furent bientôt près de moi et ce fut alors à qui aurait le plaisir de nous héberger. On nous apprit alors que nous étions à Tergnier.
Nous eûmes beau manifester notre désir de continuer rapidement notre route, arguant du besoin que nous éprouvions de rentrer le plus tôt possible chez nous, rien n’y fit. Le sous-chef de gare, lui-même, intervint, nous conseillant un peu de repos, nous promettant aussi de se charger personnellement de notre acheminement sur Paris.
Sur cette promesse, et peut-être aussi parce que nous commencions à nous sentir fatigués, nous nous inclinâmes, et, vers minuit, chacun de nous faisait son entrée dans une famille de cheminot.
Après huit heures de bon repos dans un trop bon lit, bien lavés, bien rasés, dotés de linge propre, munis de provisions fraîches, nous étions prêts à repartir.
Sans billet, mais placés sous la protection du contrôleur d’un express pour Paris, nous quittâmes Ternie dans la matinée du 17 pour arriver sans encombre dans la capitale, avant midi.
L’un de nous, Brisson Jules, n’allait pas plus loin. Avant de nous faire ses adieux il tint à passer chez un de ses anciens patrons et à partager les quelques billets de 100 francs qu’il en reçut.
Cet argent nous permit à B. Vignard, Velutini et moi-même, d’acheter trois billets aller pour Villeneuve (triage) où, dès notre arrivée dans l’après-midi, et toujours sous le couvert de ma carte S.N.C.F, nous nous présentions au sous-chef de gare de service, dans l’espoir qu’il pourrait peut-être nous aider à passer en zone libre.
Nous devions bientôt nous réjouir d’avoir fait appel à ce cheminot, qui, sans le concours de personne, nous fit monter dans un wagon couvert du type KY à quatre portes, chargé de cageots vides pour la région méditerranéenne, déjà incorporé dans un train de départ. Sur ses conseils, nous verrouillâmes de l’intérieur tous les volets ainsi que les deux portes les plus proches de l’extrémité où nous allions nous réfugier.
Bien nous prit de lui avoir obéi. Le 18 juillet au matin le train qui nous amenait s’arrêtait et stationnait plus longuement que d’ordinaire dans une gare. Des bruits de pas, une conversation en allemand, une porte de notre wagon ouverte, des coups donnés dans le chargement comme avec une sonde, nous indiquaient que nous subissions le dernier contrôle allemand. Nos cœurs battaient si fort dans nos poitrines que nous croyions en entendre le bruit. Pourvu qu’ils n’aient pas de chien, pensions-nous. Non! La porte était refermée brutalement, les pas s’éloignaient, ans le lointain une voix à l’accent merveilleusement gai chantait : «Chalons sur Saône»! «Chalons sur Saône»!
Lorsque le train repartit nous étions sauvés, mais habitués à la crainte, nous attendîmes un long moment avant de chanter notre joie en nous étreignant les mains.
Là pourrait s’arrêter le récit d’une évasion qui peut ressembler à quantité d’autres, mais dans le souci de le donner complet, j’ajouterai que c’est vers Lyon, où nous descendîmes tous trois le 18 juillet vers midi. C’est là où demeurait Velutini. A son domicile il ne devait hélas retrouver aucun des siens. Il nous accompagna sur le quai et nous fit embarquer dans un train de voyageurs à destination de Montluçon, via Roannes et Ganat.
Après Roanne, où descendit Vignard, je voyageais seul. Par Montluçon, Eygurande et Bort les Orgues, je me rendis à Aurillac que j’atteignis le 19 juillet 1942 avant midi.
Quelques jours de repos en famille me remirent en état de me présenter au C.D.D. d’Aurillac qui me dirigea vers le C.D.D de Montauban chargé du recensement des Prisonniers de Guerre «récupérés». Je fus enregistré sous le numéro 2.778 et on m’accorda 40 jours de convalescence, le 8 août 1942.
Définitivement démobilisé le 18 septembre 1942, fiche N° 6.673 du C.D.D. d’Aurillac, je me remis, après cette date, à la disposition de la S.N.C.F.