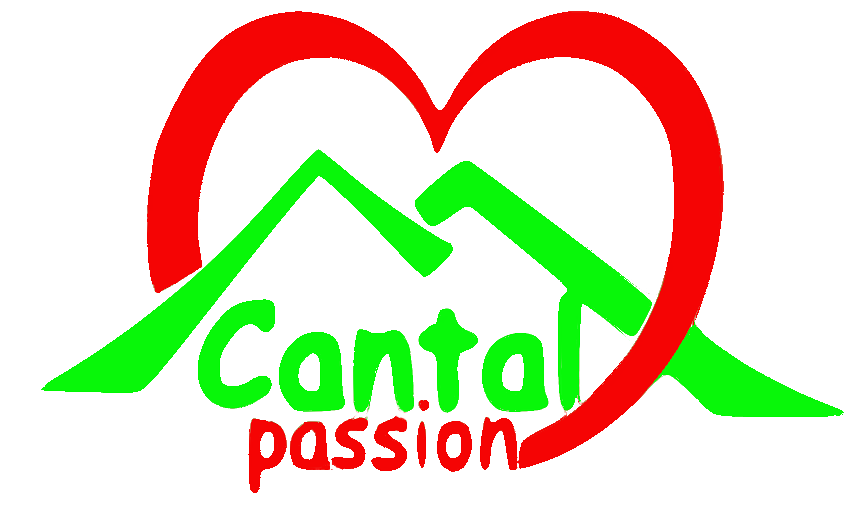V. DETENTES
Dans cette atmosphère, les coups de main apportaient les détentes nécessaires nous devions nous habiller, car nos réserves de vêtements civils en 1944 étaient minces et déjà usées, nous devions nous nourrir, ou plutôt constituer des stocks, car nos paysans subvenaient amplement à notre pitance quotidienne : pain, lard, veau, roufs, pommes de terre, ne nous ont jamais manqué, n'est-ce-pas, tous les braves gens, vous qui aviez des terroristes une opinion autre que feu Philippe Henriot, ceux de Bénéviole, et ceux de Barrès, ceux d'Aigueperse, et ceux des Fissailhies, ceux de la Drulhe, et ceux de Barrié ! Nos premiers coups de main ont eu lieu en Mars : Chantiers de Jeunesse de Mauriac; essence à La Roquebrou, bourgade délicieusement pittoresque : ses vieilles maisons accrochées au flanc de la vallée, reflétant au clair de lune leurs ombres dans la Cère; les gendarmes, prévenus, dormaient du sommeil du juste. Pas d'inquiétudes de ce côté. Il s'agissait de pomper, de la citerne d'un garagiste, mille litres du précieux carburant.
Nous avions reçu à trois la mission confortable d'empêcher un agent d'assurances suspect de sortir de son bureau où il travaillait fort tard; il était inutile qu'il voit ce qui se passait; surveillance discrète de la porte; elle s'ouvre, une mitraillette et un revolver surgissent sous le nez du pauvre homme un peu affolé "Rentrez chez vous, Monsieur, il ne vous sera fait aucun mal"; quelques balbutiements et il obtempère; nous pénétrons après lui dans un bureau bien chauffé, posons nos mitraillettes contre le mur, et, en garçons bien élevés, offrons une cigarette à notre hôte; puis nous entreprenons une petite conférence de propagande : "Enfin, Monsieur, avons-nous l'air de bandits ?" Je ne sais si nous avons fait un nouvel adepte à la Résistance.
Souvenir délicieux, que ce coup de main chez un collaborateur notoire : Monsieur C... - m'est-il permis de le nommer; peut-être me poursuivra-t-il pour diffamation - en ce mois d'Avril 1944, où tant de gens luttent et souffrent, Monsieur Causse marie son fils, cérémonie somptueuse et agapes dont on se souviendra dans la région. Il a beaucoup d'argent, Monsieur C..., et de belles relations, il recevait, dans son restaurant de Paris, leurs Excellences von Abetz et von Brinon. Nous décidons de lui rendre visite. Non pas le jour du mariage, tout de même, ayons du tact ! Mais trois jours avant. Donc, un Samedi soir, après dîner, la "milice", notre brave camionnette, - ce nom lui est resté -, se met en route, et nous emmène au rythme cahotant des fondrières du chemin de chars qui conduit à Parlan; nous nous cramponnons pour ne pas heurter la bâche de nos têtes, car elle fonce, la "milice" ! La promenade dure assez longtemps, car il faut tout de même éviter, autant que possible, la Nationale, et la route qui nous conduit à Boisset serpente dans la vallée. Notre hôte habite un hameau assez éloigné du bourg. Soudain, arrêt : Fernand, qui est aussi acrobate, juché sur le toit de la camionnette, coupe les fils téléphoniques, précaution élémentaire. Départ, virage, arrêt brusque, nous sommes dans la cour de la belle villa de notre hôte. Il s'agit d'abord d'assurer la garde et de ne laisser pénétrer personne; lorsque nous entrons dans la maison, nous trouvons toute la famille et la domesticité, bras en l'air, et visages de circonstance. Discussions rapides, et nous nous mettons au travail. A deux, nous poussons un tonneau après avoir goûté au vin - c'est humain, n'est-ce-pas ? - lorsque notre propriétaire se précipite pour nous donner un coup de main. Nous le regardons faire d'un air méprisant; est-il permis d'être aussi plat et de participer à son propre... déménagement ? Après le vin, la farine, qui va être la bienvenue chez les paysans qui nous ont fourni le pain, puis des jambons, saucissons, conserves, etc... il y avait dans cette maison, pour cette seule famille, de quoi nourrir tout un quartier de Paris ! La voiture est bientôt pleine, et nous repartons, riches de notre butin, sans aucun remords. Il y eut une belle fête, cette nuit-là dans notre modeste moulin; le Champagne coula dans des quarts qui étaient habitués à ne recevoir que de l'eau, et l'écho de nos chansons devait certainement retentir assez loin au dehors. Nous avons lâchement tenté d'enivrer nos deux Américains, et nous y sommes parvenus. Nos deux Américains ? Leur histoire vaut la peine d'être racontée.
Ils avaient tous deux sauté en parachute d'un avion en détresse au-dessus de la Hollande. L'un avait été planqué aussitôt; l'autre, fait prisonnier, avait sauté du wagon qui l'emportait en Allemagne, après avoir assommé son gardien. Dirigés d'une organisation de Résistance à une autre, ils avaient franchi deux frontières, étaient restés huit jours à Paris, dans un appartement vide, avaient été embarqués à la gare d'Austerlitz à destination de Toulouse où étaient organisés les passages en Espagne, mais, j'ignore par quel miracle, après plusieurs navettes entre Etampes et Orléans, ils étaient descendus à Loupiac, petit bourg des environs d'Aurillac où ils étaient restés un mois, cachés chez des gens courageux qui, comme les autres, avaient trouvé naturel de risquer leur vie. C'est là que Bernard et moi étions allés les chercher après une magnifique randonnée en voiture dans les gorges sauvages de la Maronne. Premier contact... Je récupère mes notions d'anglais : "Very glad to see you". Deux grands gars, Davy, brun et rêveur, Kenneth, blond et pétulant. Nous les emmenons; leurs hôtes les quittent à regret; ils ont vécu une belle aventure, et nous leur enlevons ce risque qu'ils ont couru, cette exaltation de leur vie qu'ils ont connue cette atmosphère de conspiration; désormais, tout va rentrer dans l'ordre. Après un séjour chez les parents de René qui, eux, ont l'habitude de loger les clandestins, nous les recueillons au maquis, et ils restent quinze jours avec nous. Pourquoi cacher qu'ils nous ont déçus ? C'est pendant leur séjour parmi nous que nous avons connu l'alerte provoquée par l'arrivée des Allemands à Parlan. Ils ont assisté à notre branle-bas de combat; alors Davy a expliqué : "Si nous sommes pris seuls, nous serons prisonniers. Si nous sommes pris avec vous, nous serons fusillés. Alors, nous préférons ne pas rester avec vous". Des Canadiens, des Anglais même, auraient-ils agi ainsi, n'auraient-ils pas préféré partager les risques de ceux qui les hébergeaient ? Pendant deux jours, ils ont vécu cachés dans une grotte où nous leur apportions leurs repas et ils n'ont consenti à revenir que lorsque tout danger eût été absolument écarté.
Cependant, nous les avons vu partir avec regret. Plaisir de pouvoir parler anglais, d'échanger nos idées sur les grands problèmes de l'heure, de connaître l'existence d'un Américain avant la guerre. Puis, le jour même de notre coup de main chez le Kollabo, ils sont venus, deux de Toulouse, pour les emmener : André, le liaison que nous connaissions bien, et Claire, spécialisée dans les passages en Espagne, et qui, quelques semaines plus tard, tombée dans une embuscade de la Gestapo prés de la frontière espagnole, a pu s'évader, et s'en est tirée avec quelques contusions. Claire, vous souvenez-vous de notre conversation le matin de votre départ, dans l'aube froide, tout prés de Parlan dont se devinait la tour démantelée derrière la brume qui recouvrait le lac, en attendant la voiture qui devait vous emmener ? - Bernard, une fois de plus était en retard. - Vous avez évoqué Paris, le frais matin dans lequel vous débarquiez du train et toute la beauté de la capitale. Comme nous étions loin alors des bois qui nous entouraient, et du danger. Nous n'avons pas parlé de Paris en touristes, mais comme d'une trop lointaine terre promise, comme d'un ami cher qui souffre, et dont on est privé de nouvelles. Les deux jours pendant lesquels vous êtes restée parmi nous, vous nous êtes apparue comme une collégienne, - vous, prof. '. - heureuse d'une escapade à la campagne. Et puis, vous, et nos Américains, vous êtes dissipés dans un bruit de moteur qui s'affaiblit, dans une lanterne arrière qui s'estompe dans la brume. La vie allait recommencer avec son poids de soucis et de joies, avec la grande espérance qui se précisait en même temps que la fin des mauvais jours.
Ce printemps de 1944 a été vraiment un symbole. Je n'aime pas cette saison, trop conventionnelle, qui a inspiré facilement trop de mauvais poètes. Mais alors, elle coïncidait tellement avec le déroulement des événements, qu'elle prenait toute sa signification. Ce printemps 1944 était bien l'aube du renouveau, l'aube de notre résurrection. Aussi, est-ce avec une réelle émotion que, par la première journée ensoleillée, après deux semaines pluvieuses, nous avons contemplé les fleurs blanches et roses des arbres fruitiers des Fissailhies. La nature, elle aussi, nous apportait son message. Ce fut un peu comme si nous entrions dans la lumière. Et nous oubliions trop vite que si l'avenir était plein d'espoir il apportait aussi les combats et les pertes; cela, la dure réalité, allait bientôt nous le rappeler.
Détente... Pendant nos trop rares moments de loisir, nous allions, n'est-ce-pas, vieux Pierre, ressuscitant une bienheureuse Arcadie, retrouver nos bergères parmi les champs fleuris. L'intimité de ces vallons, cachés parmi les bois de châtaigniers, aux troncs tourmentés... Loin, bien loin, des mitraillettes et des communiqués, nous retrouvions ces choses simples, un troupeau de moutons blancs, des chiens qui essaient d'être méchants, une belle fille fraîche... Elle était jolie, ma bergère, sa fine silhouette se détachant dans le soleil, au haut d'une butte, cheveux au vent, entourée de son troupeau...
Détente encore, ces bains de soleil, lorsque nous étions de garde au mois de Mai sur la butte qui dominait les bois de Fombelle, notre nouvelle résidence, à deux pas du nouveau terrain de parachutage, plus vaste que le Pied de la Poule et éloigné de son ancêtre de trois kilomètres seulement. Nous avons alors définitivement abandonné le moulin, et nous devenons de véritables hommes des bois, logeant dans des sortes de tentes au sol creusé à cinquante centimètres environ dans la terre, aux murs faits de panneaux des chantiers de jeunesse et recouverts d'une bâche. Nos effectifs se sont accrus; on nous a même donné des chefs.
De cette butte, donc, nous contrôlions du regard les routes d'accès au camp. Camouflée par des branchages, notre première et unique mitrailleuse, amoureusement entretenue, veillait. Vêtus seulement d'un slip, nous restions des après-midi entiers à épier la circulation, à contempler le panorama qui s'étendait par-delà Aurillac, jusqu'aux monts du Cantal, à paresser. Cependant, si nous goûtions cette vie de sauvages, l'inaction nous pesait. les F.T.P. du Lot, avec qui nous étions souvent en liaison, car nous leur fournissions armes et munitions, pendant ce temps, s'agitaient sérieusement. Le 1 Mai, c'était l'occupation de Gramat; les boches, prévenus téléphoniquement par les soins des maquisards eux-mêmes, n'avaient pas daigné se déranger; puis, ç'avait été la bagarre de Cajarc, contre boches et G.M.R., des pillages incessants de trains de marchandises réservées à l'occupant. Notre impatience allait être bientôt satisfaite.