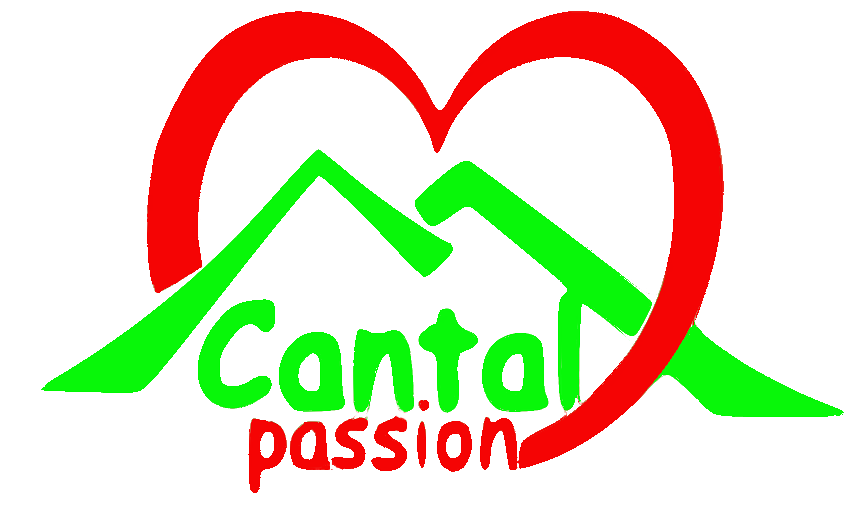3.7 10
Le téléphone.
Véronique parle : « attends j’appelle Carine. »
Nous arrivons, Carine avec ma chemise, moi le pantalon. Véronique plaque sur son ventre un coussin masquant un peu sa nudité.
« Vas-y. Nous t’écoutons ensemble. »
« Alors écoutez bien. Il faut que vous soyez folles pour laisser un tel message ! Je ne sais pas à quoi vous vous shootez ni avec qui vous baisez. »
« N’exagère pas ! »
« Ta gueule ! Écoute ! J’ai en ce moment dans mes bras une femme que j’aime. Elle va bientôt donner naissance à notre fils. Il sera sain comme nous le sommes tous les deux. Nous allons nous marier. Pour cela il faut un certificat médical. Mon contrôle a été fait. Négatif ! Tu entends ! Négatif ! Alors arrêtez vos conneries et foutez-moi la paix ! »
Le long silence qui suit est rompu par véronique : « il a raison. J’avais un peu trop bu. Je suis contente pour lui parce que je l’aime bien. »
Elle rit : « Ne regarde pas Roland. Je vais créer une ligne de vêtements avec oreiller portatif. Je ne suis pas sûre que tout soit bien couvert. Bon ! Je vous abandonne. Je vais pouvoir dormir tranquille. »
Elle court vers sa chambre, oubliant qu’elle ne porte rien qui cache la face offerte à nos regards.
Carine murmure : « Alors c’est Hervé ! Depuis longtemps je remarquais des parfums…il s’absentait …pour rencontrer des fournisseurs…Il l’avait toujours fait, mais les absences se faisaient plus nombreuses et les séjours à Paris plus longs. Je ne lui demandais plus rien. Il restait mon associé. Le père de mes enfants. Pour le reste…J’avais épousé un brillant sportif. Celui que toutes les filles poursuivaient. Lui avait trouvé un magasin. »
« Tu exagères un peu non ? »
« Oui ! Bien sûr ! Mais il y avait aussi tout ça dans notre rencontre. Nous étions si différents. Il venait d’un autre milieu. Son enfance avait été dure. Sa famille…Enfin…je croyais en avoir fini et voilà que tout me rattrape. Je vais le voir demain. Je croyais avoir à lui dire que je l’avais empoisonné alors que c’est l’inverse. C’est moi qui aurais le beau rôle. »
Lorsque je me réveille, Carine n’est plus près de moi. Je ne l’ai même pas entendue.
Elle est plongée dans un album photo. Véronique apporte le plateau de mon petit-déjeuner. « Monsieur est satisfait ? La journée de Monsieur commence bien entre sa servante et sa maîtresse. Au fait, la servante a la gueule de bois. Bon. Je vous abandonne. Laissez la clé dans la boîte à lettres et revenez bientôt. »
« Elle est un peu folle » dit Carine « je l’ai toujours connue comme ça, depuis notre adolescence. Elle plaisait aux garçons. Quand je pense à tous ceux qui ont connu son lit…et c’est moi qui… »
Elle lâche ma main : « je vais au magasin. Je préfère voir Hervé là-bas plutôt qu’à la maison. »
« Tu ne l’appelles pas pour le prévenir ? »
« Une veille de Noël ? Il est sûrement là. Je ne resterai pas longtemps. Où veux-tu que je te retrouve ? »
« Qu’as-tu prévu pour la suite ? »
« Nous pouvons déjeuner où tu veux. Nous n’allons chez Florence que l’après-midi. »
« Je vais marcher un peu. Je serai sur la Promenade d’Angoulême à partir de dix heures trente. Prends ton temps. Si le froid est trop fort je serai au bar, juste au-dessus de la digue. »
Me voilà seul. La femme de ma vie va retrouver son mari. Ce matin elle n’était plus avec moi. Trop de chocs l’ont atteinte ces derniers jours. Elle sait que je suis là, mais il faut qu’elle affronte seule certaines difficultés, comme je devrai le faire moi aussi.
Je l’imagine marchant dans les rues. On la reconnaît. C’est un village. Tout le monde sait tout. Son magasin aura changé. Les vendeuses seront gênées. Et cette rencontre !
Il faut que je me prépare à affronter Élisabeth. Sa vie sexuelle n’a pas dû s’accélérer beaucoup. Ce qui relève du sexe a toujours relevé du devoir plus que du plaisir. Au début peut-être ? Il y a l’église et ses préceptes. Et l’éducation donnée par sa mère. Heureusement qu’elle n’est plus là celle-là. J’en aurais entendu ! « Dieu m’a envoyé cette maladie. Sa pauvre petite que j’ai abandonnée… » Elle ne savait pas que depuis bien des années nous n’échangions plus rien. Mais je restais l’Antéchrist porteur de toutes les contrevérités. J’avais même réussi à détourner sa petite-fille de l’Église ! Un monstre ! Quelques jours ne changeront rien.
3.8 11
Je me décide à sortir.
J’ai apprécié cette ville. Elle fut la première ouverture pour le petit campagnard que j’étais. C’est ici que j’ai découvert ma différence. Moi, le bon élève, fils du facteur et de la gérante de l’Agence Postale. Tous mes camarades étaient fils de paysans. Á peine sortis de l’école ils travaillaient aux champs. Je pouvais courir, lire et rêver. J’étais bien habillé par ma mère qui cousait mes vêtements. Je me sentais supérieur.
La ville me ramena à ma vérité sociale.
La pension m’interdit les promenades. Á ma solitude succéda le trop plein avec sa violence permanente dans les cours où régnaient les grands. Dans un immense réfectoire nous était imposée une nourriture bizarre. Le grand dortoir alignait nos lits dans l’obscurité. J’entendais les soupirs, parfois les cris et les grincements de dents.
Au milieu de tous ces inconnus, j’étais seul. Abandonné par ceux qui me protégeaient.
Le deuxième choc fut pire qui conduisit mes parents et mes sœurs à s’installer dans la ville. Je n’étais plus pensionnaire. Et je me découvris pauvre. Á la suite d’une erreur de programmation ou de promesses non tenues nous avons dû occuper deux petites pièces dans un vieil immeuble surplombant la Jordanne. La cuisine-séjour-salle de bains-bureau de huit mètres carrés s’ouvrait sur un balcon où un bac en tôle recevait les eaux usées avant de les précipiter dans la rivière. Un WC en planches, lui aussi à évacuation directe, nous séparait des voisins.
L’escalier de l’immeuble passait entre cette pièce et la chambre où dormaient mes parents et mes sœurs. Chaque soir je devais rejoindre le lit d’une grand-tante septuagénaire occupant, avec sa fille de cinquante ans, le même appartement de l’étage au-dessous.
J’avais treize ans. L’âge de la transformation du corps et des premières amours.
Une fois chaque jour, quelquefois deux, je devais aller emplir un seau et un arrosoir à la pompe, sur le trottoir où pouvait passer un copain du lycée ou une de mes petites amies.
J’étais pauvre !
Plus pauvre que tous les autres. Je m’étais cru membre d’une caste supérieure et je touchais le fond.
Je ne sais si je croise des gens connus. Plongé dans mes pensées, je ne vois personne en retrouvant ce quartier dans lequel j’ai souffert pendant deux années. Je retrouve l’escalier étroit tournant dans la même obscurité. Chaque porte a une plaque à côté d’une sonnette. Des primes ont été offertes aux logeurs des étudiants lors de la création de l’antenne universitaire. Les appartements ont été réhabilités.
Qu’est-ce que je viens chercher là ? Je n’avais plus affronté cette rue et le souvenir de ces moments. Ils étaient perdus tout au fond de ma mémoire.
Quel besoin aujourd’hui ?
L’air froid de cette veille de noël me fait du bien.
Je me réchauffe en adoptant la marche rapide des passants.
C’est quand même chez moi. Plus que sous les tropiques. Ce vent glacial piquant mes oreilles me dit que je suis d’ici. Les collines encore vertes me sont aussi familières que les ruelles où courent des gens emmitouflés.
Là-bas c’est l’exotisme. L’océan. Les peaux brûlées par le soleil. Tous ces hommes assis du matin au soir près des débits de boisson affichaient l’alcoolisme et la pauvreté. J’aurais pu vivre là-bas encore un moment, comme n’importe où ailleurs. Mais c’est ici que je mourrai. Je le sais.
Le magasin de Carine est au bout de la rue. Cette rencontre doit être difficile. Notre retour annonce des morts.
La mort ! Elle ne m’a jamais fait peur. Elle n’est rien. Rien que la fin de la vie. Un passage obligé. Passage est d’ailleurs un mot inapproprié puisque la mort ne mène nulle part. J’ai vu mourir des proches. Souvent ils étaient vieux. D’autres ont été pris en pleine jeunesse par la maladie ou l’accident. C’était difficile pour ceux qui restaient. Pour les partants c’était fini. Ils n’étaient plus. Seul restait leur souvenir dans l’esprit de ceux qui les avaient aimés. Eux ne souffriraient plus.
Je n’ai jamais eu peur de cette absence de futur. De la souffrance oui. Retarder la mort de gens qu’ils disent aimer pour continuer à les voir souffrir est une décision insensée que certains imposent à des malades. Les mêmes croient souvent en un Dieu qui les accueillera dans son Paradis. Pourquoi retarder cette heureuse rencontre ?
Plus tôt, j’ai craint de laisser des gens qui auraient pu avoir besoin de moi. Aude est indépendante. Les petits apprendront ailleurs le peu que j’aurais pu leur apporter.
Je suis inutile.
3.9 12
Rien.
Comme pour tous ces poulets et lapins, ces porcs et ces agneaux que j’ai vu égorger, la mort n’est rien puisqu’il n’y a pas plus d’après pour moi que pour eux. Pas plus que pour les arbres et les fleurs.
La vie est un invraisemblable accident dont il ne faut rien gâcher. Et puis…rien !
Le sens de ma vie c’est Carine.
J’arrive sur la promenade où elle doit me rejoindre. Je regarde couler l’eau qui chute un peu plus bas. Je sais tout des cascades et des gorges, des grands plats et des hauts fonds depuis la source, là-haut sous le Peyre-Arse. J’ai parcouru les prairies, les bois et la montagne. C’est ici ma niche. Mon territoire retrouvé.
Seul je serais comme ce vieillard assis sur le banc. Qu’attend-il dans ce froid ? Rien sans doute ni personne. Il doit venir ici chaque jour laisser passer ses dernières heures sans intérêt.
Une main rejoint la mienne au fond de ma poche.
Elle est là !
Ses yeux sont rougis par le froid. Peut-être aussi…
« Ça s’est mal passé ? »
Elle prend mon bras et s’appuie conte moi : « Marchons un peu. J’en ai besoin. »
Nous montons vers l’ancien foirail. Nous allons bien trop vite pour la pente. La main de Carine serre la mienne. Á bout de souffle, elle cache son visage contre ma poitrine. Nous restons longtemps pressés l’un contre l’autre.
« Il est homosexuel ! Tu te rends compte ! Celui que j’ai épousé ! De qui j’ai eu deux enfants ! Il me laissait pour des mecs ! C’est …nul ! Et il va nous tuer ! »
Je suis aussi surpris qu’elle. Que pourrais-je lui dire ? Que j’ai des copains homos qui sont des gens très bien ? Qu’ils ne sont pas responsables de leur différence ? Que c’est leur liberté ? Que…
C’est donc lui. Les populations à risques, comme disent les spécialistes, certains que tous les homos multiplieraient les rencontres alors que les hétéros n’auraient définitivement qu’un seul partenaire. Nous étions à l’abri. Et puis…
« Entrons dans un bar. Tu boiras un café. »
« Non. Je ne veux voir personne. Je me sens sale. J’ai l’impression que tout le monde est au courant. Qu’on me juge. Ou pire : qu’on me plaint. Retrouvons la voiture. »
Elle me tend la clé en s’asseyant, les genoux serrés dans ses bras.
Je tends l’oreille pour comprendre ce qu’elle murmure : « tout le monde m’a fait fête. Je crois qu’ils étaient vraiment heureux de me revoir. Ils m’ont dit leurs joies et leurs problèmes. C’est vrai qu’ils n’avaient plus mon oreille attentionnée depuis longtemps. J’ai trouvé Hervé dans son bureau. Il a pâli je crois. Il s’est levé, m’a tendu la main en bafouillant - on s’embrasse - et puis il s’est mis à rire. Comme il le fait depuis toujours quand il veut gagner du temps.
Nous avons parlé des enfants, du magasin, des amis…
Enfin je lui ai dit : je suis séropositive. Je pense que ça vient de toi. Il faudrait que tu préviennes tes maîtresses et que tu fasses un contrôle.
Il était gris. Il s’est affalé, la tête dans les bras. Il sanglotait. J’entendais ses hoquets. Je ne savais pas quoi faire. J’aurais voulu l’aider. Je regrettais ma brutalité. C’est la première fois que je le voyais s’effondrer. Il était l’homme fort. Toujours si sûr de lui. Le battant. D’un coup il s’est redressé en disant - il y a si longtemps que j’ai peur. Tout va être plus simple. Comment te dire ? Par où commencer ?-
J’avais envie de partir en disant que cela ne m’intéressait pas. Je n’ai pas pu.
-Il faut que je prenne au début. Tu sais que je n’ai pas de père. Ma mère a connu beaucoup d’hommes. J’avais onze ou douze ans quand celui-là s’est installé chez nous. J’ai oublié son nom. Il était toujours là, même quand ma mère travaillait. Je le trouvais gentil. Il s’occupait de moi. Un jour il a commencé…ça a duré longtemps. Je ne pouvais rien dire. Il me menaçait. Enfin il est parti. Je me suis mis au sport. Dans ce monde macho je faisais comme les autres. Je riais des pédés. Je méprisais les tantes et les tapettes, tous ceux qui étaient des sous hommes. J’avais enfermé tout ça au fond de ma mémoire avec bien d’autres mauvais moments de mon enfance. Aucun doute ne m’effleurait dans les vestiaires d’après match, pas plus que dans les douches communes.
Je t’ai aimée.
Un jour…c’était à Paris…j’étais seul. Á la fin d’un salon j’ai suivi un commercial avec qui j’avais sympathisé. Il m’a emmené dans une boîtes gay. Nous avons beaucoup bu. Nous avons passé la nuit ensemble. Je prenais du plaisir et je m’en voulais. Nous sommes restés ensemble trois jours.
Il fallait peut-être ça pour effacer mes souffrances enfantines.
En m’éveillant, le dernier matin, avec la gueule de bois de tout ce que j’avais bu et fumé, j’ai eu un accès de violence. Je l’ai frappé avec mes poings et mes pieds. Il y avait du sang partout.
J’aurais pu le tuer.

3.10 13
Quand je suis sorti de la douche, il était assis sur le lit. Il m’a dit : -je sais que tu reviendras. Je t’attendrai-
J’ai plongé dans l’escalier. Je voulais vraiment sa mort.
Et c’est de la mienne qu’il s’agit. De la notre puisque je t’entraîne aussi. Je suis responsable. Comme celui qui abandonna ma mère. Comme ceux qui profitèrent d’elle. Comme celui qui a sali mon enfance. Comme celui de Paris…
Je croyais en être sorti. Les relations sexuelles ne faisaient plus partie de ma vie. Au moins suis-je certain de n’avoir contaminé personne d’autre.
Je sais que tu ne pourras pas me pardonner-.
Je suis partie sans un mot. Comme lui, le jour où il a frappé ce pauvre type… Au début de son récit j’avais envie de le détruire pour qu’il se taise. Il n’est qu’une victime. »
Je ne trouve rien à dire. Je la sens si loin, si seule.
« J’ai peur que tu prennes froid. Nous allons rouler un peu. »
« Il faut aller chez Florence. Je dois acheter des jouets pour les enfants. Mais pas ici… »
« Nous nous arrêterons au Lioran pour manger et marcher. Nous ferons les achats à Saint-Flour. »
Nous roulons en silence. Si proches et pourtant séparés. Comment l’aider ? Á quoi suis-je bon si je ne trouve rien à dire quand elle est malheureuse ? Il s’agit de sa vie d’avant…
Il fait beau. La vallée de la Cère est encore verte malgré les arbres dépouillés. L’eau ruisselle en inventant des cascades à chacun des détours de la route. Les sommets blancs dominent les forêts de résineux.
La chaleur nous pénètre.
La main de Carine se pose sur ma joue.
« Comment ferais-je sans toi ? J’ai empoisonné ton corps et j’assombris cette belle journée. Demain c’est Noël. Je vais voir mes petits. La fête sera belle pour eux. Qu’importe le reste. Je te promets de ne plus pleurer. C’est le choc. C’était tellement inattendu. Sale et triste. Il a pu me cacher toutes ses souffrances pendant des années. Moi qui lui disais tout. »
« Peut-être lui fallait-il garder ce secret bien enfoui pour pouvoir vivre, pour l’oublier lui-même. L’enfance a tellement d’importance pour la construction d’un humain. Tout ce qui nous arrive là nous marque. Alors l’absence de père, la misère, il fallait qu’il soit fort ! »
« Tu es extraordinaire ! » dit Carine en retrouvant son rire « tu es en train de défendre mon ancien mari. Celui qui nous tue. C’est quand même original ! »
Nous quittons la voiture en riant. Comme on le fait après un accident ou lorsqu’on a besoin d’évacuer une tension trop forte.
Ainsi que le feraient deux adolescents inconscients du monde environnant, nous échangeons quelques boules de neige.
Un long baiser fait fondre les idées noires avec la neige de nos visages.
« Allez madame ! C’est la fête. La fête des enfants et de tous ceux qui ont su garder une âme jeune. »
« Un miracle! Je t’entends parler d’âme ! Toi l‘athée endurci ! Allez, mon frère, viens manger. Il nous faut des calories pour lutter contre ce froid. Quand je pense qu’il y a deux jours nous brûlions nos plantes de pied sur le sable de l’Étang Salé ! Qui a dit que la vie la plus triste est celle où rien ne change ? Là j’ai envie de dire pouce ! J’aimerais bien que le changement ralentisse un peu. »
« Pense au sketch de Muriel Robin apprenant que sa fille attendait un enfant. Qu’elle allait se marier. Qu’il était africain. Qu’ils partaient vivre là-bas… »
« C’est exactement ce que je ressens. Je n’ai pas le temps d’encaisser la première nouvelle qu’une autre me tombe dessus. Mais tu vois que moi, je ne me roule pas par terre comme ton humoriste. Je suis forte moi monsieur. »
Nous déjeunons très simplement. Pour nous distraire, nous essayons de reconnaître les couples illégitimes profitant d’une escapade dans ce coin perdu de montagne. Quand nos yeux se retrouvent nos préoccupations reviennent.
« Nous ne sommes pas au bout. Je vais devoir affronter Élisabeth. »
« Plus tard. Elle ne doit pas contaminer grand monde. Nous allons vivre ces jours de fête comme si tout était fini. Après…nous reprendrons le chemin. Depuis que j’ai appris que ce n’était pas Francis je me sens moins fautive. C’est moi qui t’ai apporté la maladie, mais je ne pouvais pas l’éviter. »
« Souviens-toi : il n’y a plus Je, il n’y a plus Tu, seul Nous existe. Nous allons affronter cette maladie ensemble. Qu’importe son origine. »
« Tu as raison. Allons marcher. »
3.11 14
Nos chaussures citadines interdisent la neige profonde. Nous restons sur les tracés gelés.
Malgré l’allure soutenue de notre marche, le froid nous pénètre peu à peu. C’est en courant que nous regagnons la voiture.
Nous partageons la découverte des paysages de la vallée de l’Allagnon. Les cascades soulignent les moindres plis. Les grands sapins s’illuminent de blanc dans le soleil qui se prépare à passer la montagne.
Nous traversons Murat dont les maisons enneigées s’encadrent dans nos rétroviseurs alors que nous montons vers le Piniou.
« Un vrai paysage de Noël ! » nous exclamons-nous en même temps.
Nous arrivons vite à Saint-Flour et ses ruelles glaciales. Carine choisit les jouets pour la petite qui en possède déjà des coffres pleins. Malgré nos réticences, nous allons, nous aussi, lui apprendre à consommer. L’amener à oublier vite ce qu’elle aime pour aller vers autre chose. Nous qui nous élevons contre les abus et les dangers de cette éducation, nous allons renforcer la tradition imposée depuis un demi siècle par les marchands.
Nous achetons du champagne, du foie gras et des huîtres comme tous les clients de ce jour-là.
Carine prend le volant pour les derniers kilomètres. Je sais qu’elle est heureuse, même si elle appréhende un peu cette journée. Elle avait laissé sa famille pour fuir au bout du monde. Elle arrive avec un autre qui n’est pas le grand-père d’Ophélie.
« Je les connais tous les deux. Je crois qu’ils m’aiment bien. Comme on aime le vieux prof qui rappelle de bons souvenirs. Florence n’a passé qu’une année avec moi, mais Patrick a été mon élève de la sixième à la terminale. Je l’ai vu grandir. Je lui ai appris à skier comme à nager. Nous avons fait de nombreux déplacements ensemble et gagné de grands matchs. »
« Vous ne perdiez jamais sans doute ! »
« Rarement. Si peu que c’est vraiment négligeable. «
Nous rions ensemble, cette fois-ci de bon cœur. La traversée cantalienne a chassé les idées sombres.
Voilà l’école.
Le sapin est dans la cour. Chacun des villageois peut ainsi profiter de ses guirlandes.
« Ils ont fait le bon choix en restant dans ce village. Les enfants sont au cœur de la nature. Aucun stress ne les bouscule. Ils ont tout pour être heureux » dis-je alors que Carine gare la voiture sous le préau.
« C’est une heure pour arriver ? Nous sommes allés trois fois vous attendre sur la route en répétant –Mamy et Roland arrivent- Ophélie ne nous croit plus » proteste Florence depuis la fenêtre de l’étage.
Patrick vient nous aider. Son sourire me fait du bien. La relation des jeunes qui aiment le sport avec leur prof de gym est lus intense qu’avec les autres enseignants. J’ai entendu beaucoup de confidences, pansé des blessures, partagé des chants…nous retrouvons ces souvenirs.
Ophélie, bloquée sur les marches du perron, ne sait si elle doit aller vers ces envahisseurs ou retourner vers les bras de sa mère.
« C’est avec eux que tu courais sur la plage » dit sa mère « tu jouais à cache-cache dans les rochers et tu grimpais dans les arbres… »
« C’est nous les fous » dit Carine en soufflant un baiser dans le cou de sa petite-fille.
« Viens voir ma chambre. J’ai des poupées et même un bébé noir. »
« C’est Mamy qui te l’a envoyé. Tu te souviens du film où Roland le portait dans ses bras » rappelle Florence qui se tourne vers moi pour ajouter : « les films animent souvent nos soirées. Il faut revoir sans cesse la mer et les fleurs. Et l’avion aussi. Elle les connaît tous par cœur. »
« Nous avons souvent regardé les vôtres quand nous nous sentions un peu trop seuls » dis-je en l’embrassant.
Leur accueil me rassure. Ils ont accepté notre histoire. Florence aime sa mère. Son père aussi sans doute. Elle respecte leurs choix.
Ah ! Si Aude pouvait raisonner de la même manière ! S’agit-il de raison ? N’est-ce pas plus profond ? Plus égoïste sans doute.